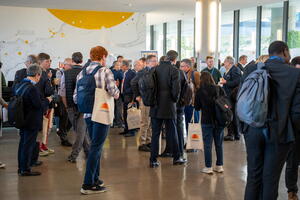L’IA dope l’innovation dans le domaine de la fusion
Alors que, dans le monde entier, les organisations travaillent sans relâche pour domestiquer la fusion nucléaire, les progrès de la technologie informatique pourraient leur donner le coup de pouce nécessaire pour franchir la ligne d’arrivée.
Les outils informatiques tels que l’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle ou augmentée et les jumeaux numériques font déjà la preuve de leur immense potentiel en remodelant la manière dont les scientifiques et les ingénieurs abordent les quatre défis communs à tous les projets de fusion nucléaire : trouver des matériaux capables de résister à de puissants flux de neutrons, atteindre un fonctionnement en régime permanent*, gérer des charges thermiques extrêmes et optimiser le cycle du combustible de fusion.
Aujourd’hui très concrets, ces outils font l’objet de programmes de recherche intensifs dans les secteurs public et privé, chacun d’entre eux apportant de nouveaux éclairages qui accélèrent le progrès.
Accélérer le développement dans le secteur privé
En avril, l’édition 2025 de l’atelier ITER/secteur privé sur la fusion a délivré un message très clair : les nouvelles technologies informatiques pourraient révolutionner la recherche et le développement dans le domaine de la fusion. Ces avancées sont applicables à un large éventail de domaines, de la science des matériaux et du contrôle du plasma au génie logiciel et à la conception de matériel. Elles facilitent également les tâches administratives courantes et l’assistance informatique.
« L’IA bouleverse notre monde d’une manière inimaginable », a souligné lors de son intervention Kenji Takeda, directeur de la recherche et de l’incubation chez Microsoft Research. Il a expliqué comment, dans d’autres domaines scientifiques, les modèles d’IA générative tels que Microsoft MatterGen facilitent la découverte de nouveaux matériaux en générant des structures moléculaires qui répondent à des critères formulés par requêtes, comme on demanderait à ChatGPT d’écrire un poème. Les émulateurs d’IA, par exemple Microsoft MatterSim, sont capables de simuler le comportement de ces matériaux dans différentes conditions d’essai plusieurs milliers de fois plus rapidement que les outils de calcul actuels.
Cette approche pourrait épargner aux chercheurs plusieurs années d’expérimentation empirique. Microsoft a démontré son utilité en concevant de nouveaux matériaux qui offrent un module de compressibilité supérieur à 400 gigapascals, ce dont seraient incapables la plupart des méthodes de sélection classiques. « Nous commençons ainsi à parler le langage de la nature, a dit Kenji Takeda. Des électrons aux cellules et à l’ensemble de la planète, l’IA peut nous aider à modéliser et à comprendre ces systèmes complexes. »
La contribution de Microsoft s’inscrit dans une tendance plus large : les acteurs industriels appliquent l’IA à la recherche théorique mais aussi aux processus d’ingénierie concrets. En outre, ce qui fonctionne dans un domaine se révèle très souvent utile dans d’autres.
Lors de l’atelier chez ITER, David Gates, directeur des nouvelles technologies chez Thea Energy, a expliqué comment les jumeaux numériques et la CAO paramétrique pouvaient simplifier la conception des réacteurs de fusion en générant des structures de chambre à vide sur la base de géométries de plasma répondant à des tolérances précises. Il a souligné l’intérêt de l’apprentissage automatique, en particulier les modèles informés par la physique qui utilisent des lois du monde réel pour prévoir les comportements et guider le contrôle des systèmes. « Il s’agit d’utiliser les actionneurs et les capteurs de manière cohérente afin de stabiliser le plasma en temps réel », a-t-il précisé.
L’émergence de plateformes d’IA natives combinant de multiples modes de raisonnement vient compléter ces efforts. La start-up d’IA new-yorkaise Arena a développé une plateforme baptisée Atlas, un système d’IA natif qui associe le raisonnement physique à des modèles de langage de grande taille. Déjà utilisé pour simplifier les processus d’ingénierie chez AMD, Atlas facilite la conception, le débogage et l’optimisation des systèmes complexes.
Mike Frei, directeur général et responsable des produits matériels chez Arena, a affirmé que cette même plateforme pouvait accélérer les travaux de développement des programmes de fusion. Selon lui, deux facteurs peuvent aider les modèles d’IA à accélérer l’innovation matérielle. Tout d’abord, le raisonnement humain complexe. Les modèles comme ceux utilisés par Atlas font appel à des procédures de raisonnement pas à pas pour résoudre les problèmes complexes. « Certains modèles s’en sortent très bien avec les problématiques de niveau doctorat dans des domaines comme les mathématiques et la physique, et d’autres sont déjà experts en programmation et n’ont rien à envier aux meilleurs codeurs de la planète », a-t-il observé.
Deuxième facteur : la multimodalité. « Il faut recueillir de nombreux éléments de contexte qui ne sont pas pris en compte dans une simple simulation et ne relèvent pas de la seule électrotechnique », a-t-il expliqué. Atlas combine des données relatives aux capteurs, des schémas et des instructions logicielles dans une même interface d’IA. Il s’intègre aux instruments de laboratoire, génère des micrologiciels et apprend de chaque interaction afin de faciliter les tâches futures.
Simplifier les travaux dans le secteur public
L’impact de l’IA ne se limite pas aux start-up et aux expérimentations du secteur privé. Au sein d’ITER, le plus gros programme de fusion au monde, ces technologies sont appliquées dans tous les domaines, de l’administratif à l’opérationnel et de l’ingénierie au scientifique.
ITER a récemment numérisé sa vaste base de connaissances, riche de plus d’un million de documents, à l’aide d’un modèle OpenAI affiné. Les ingénieurs peuvent désormais accéder à cette mine d’expertise à l’aide d’un robot conversationnel entraîné aux contenus internes, qui offre une interface plus naturelle et des modes d’interrogation de la base de connaissances plus intuitifs.
Microsoft Copilot et GitHub Copilot ont déjà été déployés chez ITER pour accélérer le développement et le dépannage des logiciels. L’IA a été utilisée pour inspecter les soudures de l’imposante chambre à vide du tokamak par vision numérique, confirmant ainsi son intégrité structurelle. Le service d’assistance informatique s’est lui aussi mis à la page et fait désormais appel à l’IA pour la résolution des tickets d’assistance technique, ce qui permet aux ingénieurs de se concentrer sur des tâches plus utiles.
Les effets de l’IA se diffusent dans tout l’écosystème environnant par effet domino. Tout près d’ITER, au CEA de Cadarache, le centre de recherche sur la fusion WEST a lui aussi adopté des stratégies fondées sur l’IA. Comme l’indique Xavier Litaudon, directeur de recherche au CEA, les chercheurs du programme WEST ont entraîné les systèmes d’IA à détecter automatiquement les points chauds sur les images infrarouge de la première paroi pendant le fonctionnement, ce qui réduit les risques de détérioration des éléments face au plasma et contribue à allonger la durée des plasmas dans des conditions sûres et plus stables.
« Nous avons appliqué cette approche aux simulations d’ITER », a-t-il expliqué lors de son intervention sur la série d’expérimentations de fusion révolutionnaires récemment menée par son organisation, qui s’est conclue par une décharge de 22 minutes. L’IA améliore la sûreté, la reproductibilité, la fiabilité et les performances opérationnelles grâce à l’apprentissage du comportement des décharges antérieures.
Elle jouera un rôle important lorsque les plasmas d’ITER commenceront à générer des données expérimentales. Selon Alberto Loarte, qui dirige la division Science d’ITER, l’IA sera utilisée pour contrôler la cohérence des données acquises et, lors de la production de ces données, elle permettra d’interpréter les mesures de manière plus fidèle que les outils classiques. Avec la croissance de la base de données qui recueille les informations issues des expérimentations concrètes d’ITER, l’IA permettra d’explorer différentes méthodes pour améliorer les performances du plasma.
« Mais nous n’avons pas besoin d’attendre qu’ITER produise des résultats expérimentaux, dit Alberto Loarte. L’IA est dès à présent capable de générer des modèles de processus physiques rapides et précis, qui permettent de décrire avec beaucoup de fidélité et de rapidité le comportement des plasmas d’ITER. Ces modèles fondés sur l’IA peuvent être utilisés pour développer un jumeau entièrement numérique d’ITER, pour les systèmes d’ingénierie ainsi que pour les scénarios plasma et les processus physiques associés. Ce jumeau permettra de simuler le fonctionnement d’ITER sous la forme d’un système complet et réaliste. »
ITER a récemment développé un jumeau numérique de l’installation alimenté en temps réel, qui intègre des images de drones, des numérisations 3D et de la documentation technique. Ce modèle immersif est accessible via des tablettes et des casques de réalité virtuelle, ce qui permet aux ingénieurs de comparer la construction en temps réel à la conception et de signaler les écarts instantanément.
Tous ces exemples illustrent la manière dont les outils informatiques – apprentissage automatique, IA générative ou encore modélisation immersive – facilitent le travail des équipes à tous les niveaux. Le consensus est clair : ces outils rendent la recherche sur la fusion plus agile, plus collaborative et plus précise. Ce n’est pas encore demain que la fusion alimentera les logements en électricité mais, avec l’IA et les autres technologies numériques, ce futur se fait de plus en plus proche.
*Fonctionnement en régime permanent : production d’énergie de fusion pendant une durée illimitée avec un gain d’énergie de fusion élevé.