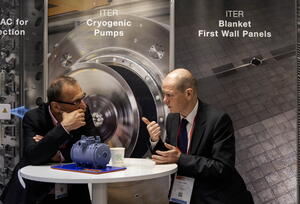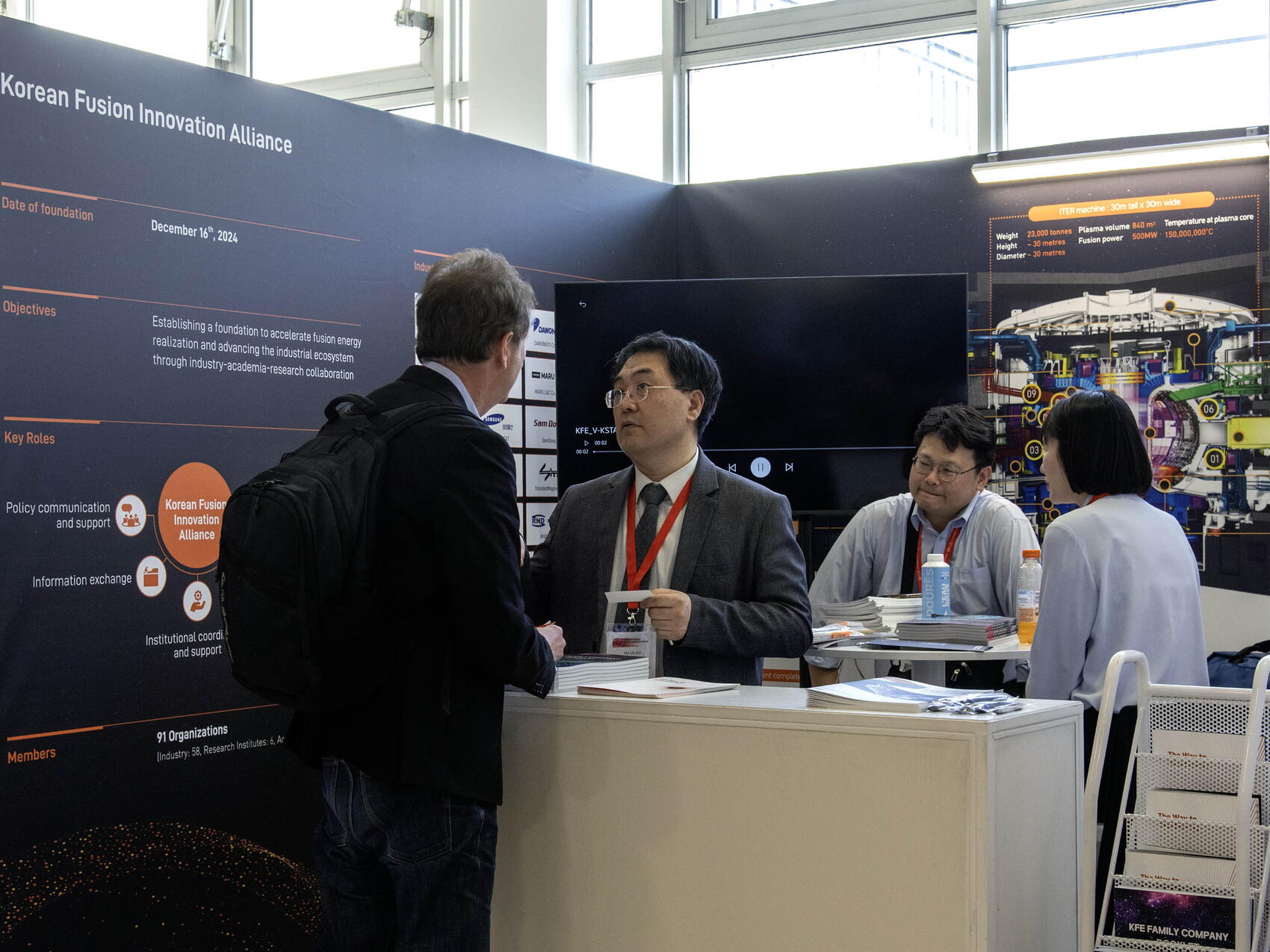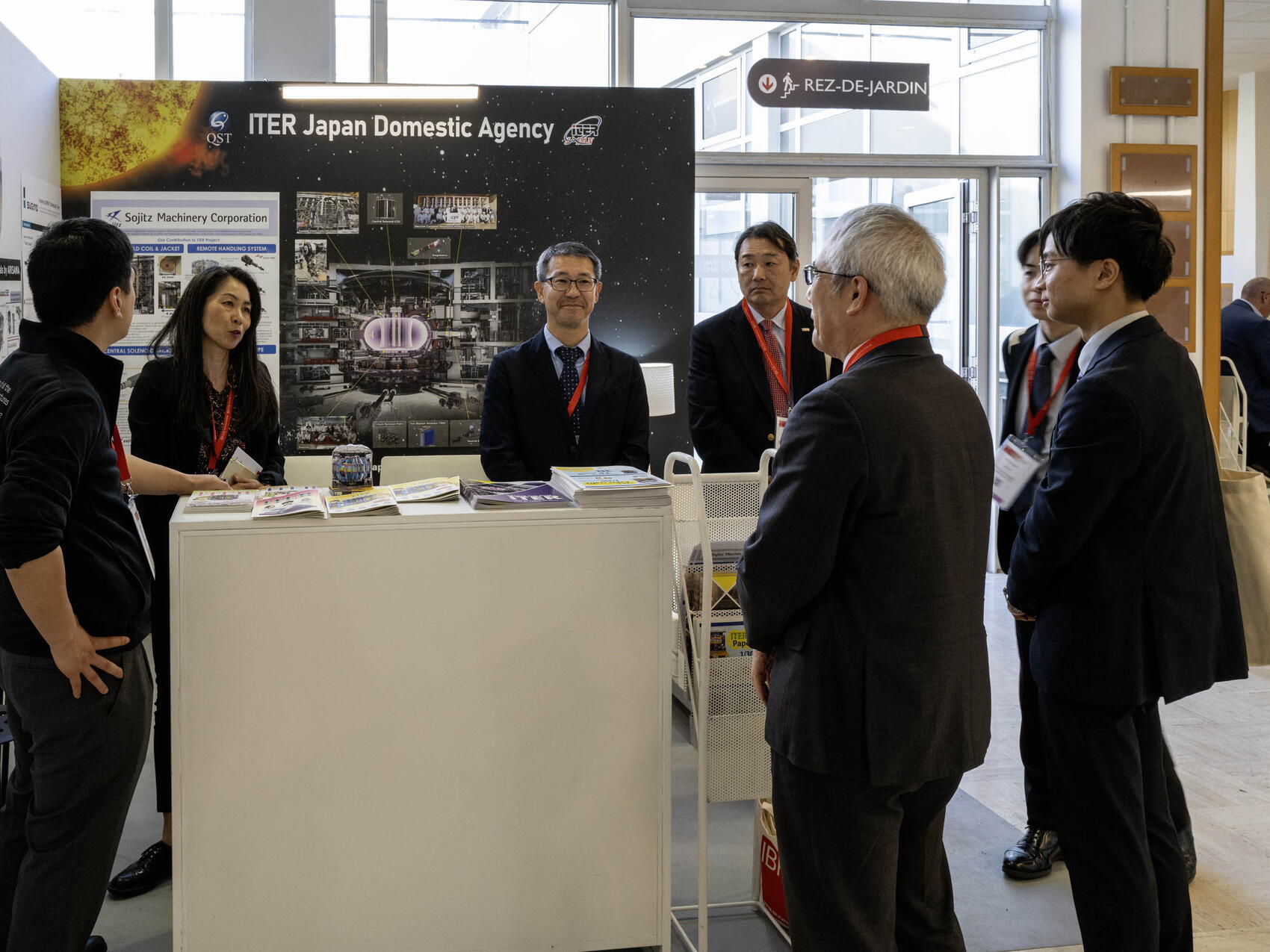Des entreprises toujours plus nombreuses
En 2007, alors que les travaux d’aménagement du site venaient tout juste d’être engagés à Saint-Paul-lez-Durance/Cadarache (13), le premier ITER Business Forum voyait le jour avec pour objectif de mettre en contact le monde de l’industrie et les différents acteurs du programme ITER. Au fil des années, la manifestation a gagné en ampleur autant qu’en diversité, rassemblant des entreprises toujours plus nombreuses, de toute taille et de toute origine géographique. Organisée par l’Agence Iter-France (AIF), une émanation du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), la 8e édition de l’ITER Business Forum (IBF/25), à Marseille les 23 et 25 avril, a rassemblé 1 200 participants représentant 630 entreprises – un record.
Pour tout un ensemble de raisons, au premier rang desquelles les conséquences de la pandémie de Covid-19, l’ITER Business Forum (IBF) n’avait plus été organisé depuis 2019. « Vous nous avez manqué ! » a dit Fabrice Raynal, le directeur d’AIF, aux participants réunis dans l’amphithéâtre du Palais des congrès du Parc Chanot. L’édition 2025 intervient à un moment critique dans le développement du programme ITER. « En 2022, nous avons connu de sérieuses difficultés, a reconnu le directeur général d’ITER Pietro Barabaschi. Aujourd’hui, la perspective est différente. Nous avons enregistré un taux d’exécution record en 2024, les pièces défectueuses ont été réparées, une nouvelle organisation, matricielle, a été mise en place et, en assemblant un « module » de chambre à vide en six mois et dix jours contre 18 mois précédemment, nous avons accompli ce qui était considéré comme techniquement impossible. » Quant à la nouvelle feuille de route, elle « promet de livrer rapidement des résultats scientifiques significatifs. » Ces succès, a tenu à souligner Pietro Barabaschi, doit tout à « ceux qui travaillent avec leurs mains et traduisent les financements en réalisations concrètes. »
Et le travail est loin d’être terminé : 1 300 contrats sont en cours avec quelque 600 entités différentes pour une enveloppe totale de 2,7 milliards d’euros ; 90 nouveaux contrats ont été conclus depuis le début de l’année 2025 pour une valeur de 180 millions d’euros. « Des systèmes conséquents, dans les domaines du diagnostic et de l’outillage, doivent encore nous être livrés », confie Mack Stanley, le responsable de la Division Achats d’ITER.
L’IBF est le lieu où les sous-traitants de longue date s’informent des évolutions du programme et de ses besoins, côtoient de possibles partenaires, partagent leur expérience et peuvent envisager de nouvelles collaborations. « Le monde de l’industrie nous connaît bien désormais, dit Mack. Je pense que nous sommes parvenus à dissiper l’essentiel du ‘mystère’ qui enveloppait le programme et ses objectifs. »
L’IBF permet également de préparer des collaborations plus lointaines. Pour cette toute nouvelle start-up française, c’est la perspective de contribuer à la fourniture d’hélium, présentement assurée par le Qatar ; pour le pôle de compétence Nuclear Valley, originaire de Bourgogne, il s’agit, au travers d’un « Club Tritium » tout juste créé, de se positionner pour le grand défi de la production in situ de tritium, l’un des deux composants du combustible de la machine.
L’édition 2025 de l’IBF reflétait l’un des changements majeurs intervenus ces dernières années dans le domaine de la recherche sur la fusion. Six ans plus tôt, lors de l’IBF 2019 à Antibes, le concept de start-up privée n’existait quasiment pas. Cette année à Marseille, la présence d’entreprises privées était significative. ITER avait délibérément programmé la deuxième édition de son « Atelier public-privé », une manifestation initiée l’année précédente, à la veille de l’IBF de manière à permettre aux représentants des initiatives privées de participer aux deux événements. « Accueillir et créer du lien, c’est notre approche du monde des start-up, résumait Pietro Barabaschi. Et le bénéfice est mutuel. » La collaboration public-privé permet « d’identifier les impasses technologiques » et « d’éviter de glisser sur les mêmes peaux de banane… »
L’IBF 2025 a également été caractérisé par une forte participation de petites et moyennes entreprises. « Ces sociétés disposent souvent de compétences fortes dans des technologies de niche, explique Eve-Mary Ries, qui dirige le Comité industriel ITER. Les PME-PMI ont longtemps considéré qu’il était difficile d’entrer en contact avec ITER. Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est que cette perception appartient au passé. »
Depuis sa première édition à Nice, puis à Manosque, Toulon, Washington, Antibes, Avignon ou Séoul, en Corée, l’IBF, dans un esprit de compréhension mutuelle, a joué un rôle essentiel dans le développement du lien indispensable entre ITER et l’industrie. Ce faisant, au terme de 18 années d’existence, la manifestation a suscité un véritable « écosystème pour la fusion » à l’échelle planétaire.